Plaisir de lire, désir de plaisir
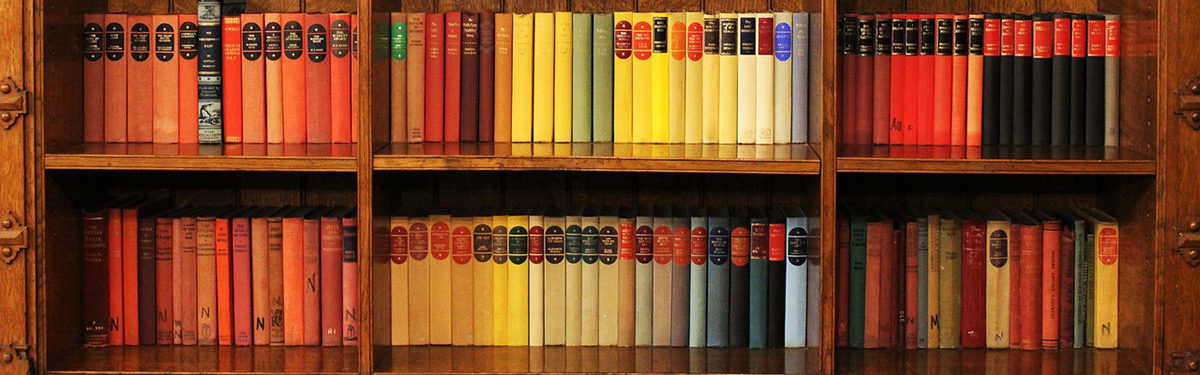
Une partie de notre jeunesse, gavée d’images, tend à considérer la lecture comme un loisir dépassé, voire élitiste. Cette perception absurde reste compréhensible tant que l’enfant associera la lecture à une contrainte scolaire. Soumise depuis plusieurs années à une rude concurrence sur le marché des loisirs, elle a perdu son côté universel pour devenir le privilège de quelques-uns.
Mon expérience personnelle s’inscrit hélas dans cette tendance. Au cours de mes années de collège, les manuels de français mis à ma disposition me paraissaient avoir vécu un siècle. Génération après génération, ces bouquins avaient fini par absorber l’odeur poussiéreuse des salles desquelles ils ne sortaient jamais.
La plupart de ces ouvrages avaient vocation à stimuler un potentiel désir de lecture. Et de quelle façon ! Je revois, au détour d’une page jaunie, le portrait granuleux d’un Robert Sabatier tout en pipe et lunettes, dont l’œil malicieux s’étalait sous un extrait de ses fameuses Allumettes suédoises. Le tout était accompagné d’un petit encadré vantant « le bonheur de lire ». J’avoue sans rougir avoir été franchement rebuté par cette communication poussiéreuse. Au fil des pages, une odeur de vieux s’insinuait jusqu’à mes jeunes narines. C’était foutu. Quant à Robert Sabatier, ce souvenir m’a empêché de faire plus ample connaissance. À tort, j’en conviens.
Donc, à plaisir d’autrefois, communication d’autrefois ? Surtout pas. Il suffirait de peu pour redonner un coup de jeune aux plaisirs lettrés. Voici donc quelques idées en vrac.
Le désir de lecture doit naître d’une pulsion intime. Rien n’est plus contre-productif que de dire à quelqu’un « avant de lire ceci, tu devrais lire cela ». Ce type d’injonction ne fait que culpabiliser le jeune lecteur et éteindre son désir.
Le pouvoir de suggestion de la lecture permet de se reconnecter à son imaginaire. Si l’audiovisuel propose du rêve prémâché, quel plaisir de rester le seul maître du petit théâtre qui défile dans notre esprit à mesure que les mots s’impriment.
Nos séries contemporaines n’ont rien inventé. Le principe du feuilleton – découper une histoire en maintenant le suspense d’un épisode à l’autre – remonte à la presse du dix-neuvième siècle. Dans un contexte de forte concurrence, il fallait vendre du papier : le souci d’efficacité était donc déjà lié aux questions d’audience.
La culture populaire regorge ainsi de romans oubliés ou méconnus, souvent dotés d’un style accessible et d’une intrigue solide. Au-delà des classiques de Dumas, on peut redécouvrir les romans de Paul Féval ou Michel Zévaco, dont plusieurs ont été adaptés au cinéma.
L’accès aux classiques peut aussi passer par des œuvres plus modernes. Le Plus Grand Philosophe de France de Joann Sfar, par exemple, donne envie de se plonger dans Spinoza !
N’oublions pas non plus le roman graphique. À la croisée de la bande dessinée et de la littérature, il peut constituer une formidable porte d’entrée vers le monde des livres. Will Eisner a donné ses lettres de noblesse au genre en publiant Le Contrat en 1978. Depuis, une multitude d’œuvres ont vu le jour.
Le livre crée un pont précieux entre les générations. La plupart des romans dits classiques ont d’ailleurs été écrits par des auteurs contemporains de l’époque qu’ils décrivent. Ainsi, les descriptions de Zola dans les Rougon-Macquart peuvent être lues aujourd’hui comme autant de reportages d’actualité.
Beaucoup de grands films sont, à l’origine, des adaptations de romans. Quand les cinéastes sont en panne d’inspiration, ils puisent naturellement dans l’extraordinaire vivier de la littérature.
Le roman reste l’un des rares espaces de totale liberté créative. Les auteurs peuvent écrivent ce qu’ils veulent, sans la moindre contrainte budgétaire. Ce cadre sans limites ouvre un merveilleux champ des possibles.
Lire demeure un plaisir peu onéreux. De nombreuses librairies proposent des ouvrages d’occasion pour moins d’un euro. Un simple passage chez un bouquiniste suffira à convaincre les plus sceptiques.
La lecture, comme n’importe quelle activité, doit rester associée au plaisir. Rien n’est possible sans cela. La diversité des styles est telle que chaque sensibilité peut y trouver son compte.
Et pour conclure, tout ne semble pas perdu: les statistiques de lecture en 2017 étaient supérieures à celles de 2015 — notamment chez les 15-24 ans.
Puissions-nous donc nous en réjouir, mais pas sûr que la tendance ait perduré




